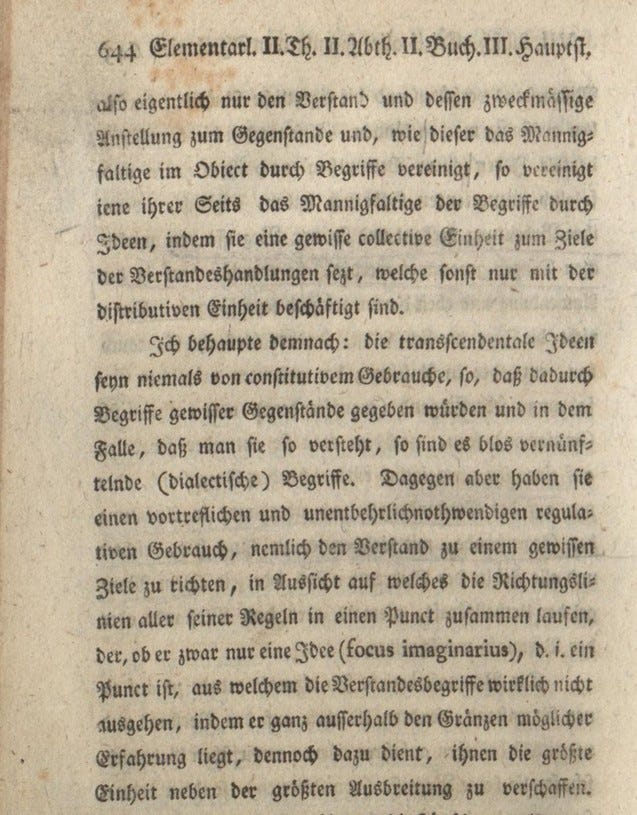1/4
2/4
3/4
« La rason es pas qu’un buòu que cal cargar sarrat e menar fèrme. » — Ives Roqueta
« D’abord ils sont venus chercher ceux qui employaient l’expression Théorie critique d’une manière confuse et je n’ai rien dit, je ne m’en servais que dans le sens historique précis de l’École de Francfort. » Benjamin Aldes Wurgaft
Voilà de quoi il s’agit avec Moby Dick, la baleine du livre d'Herman Melville : c’est un Blanc. En plus, c’est un gland (en Anglais : « dick »). Jacques Lacan s’était beaucoup penché sur le gland (ou plutôt « Le phallus »), qui pour lui représentait le signifiant à la recherche du signifié, le gland face-à-face à ce vide terrifiant que Kant appelle le Sublime.1 Moby-Dick, c’est le glandeur moyen qui remplit des fonctions dont il ne connaît pas lui-même la signification :
« Qu’elle soit mandataire, qu’elle soit responsable, je déchaînerai ma haine sur la baleine blanche. »
“And be the white whale agent, or be the white whale principal, I will wreak that hate upon him.” [Chapitre 36]
Pas besoin de Lacan pour nous dire ça : Les professeurs de littérature américaine ont longtemps soutenu qu’avec Moby Dick, Melville tente de forger une manière de lire le monde, une épistémologie à contre-courant de Kant et de Cousin :
« On a passé un temps extraordinaire & on ne s'est séparés qu'après deux heures du matin. On a parlé métaphysique sans trêve, on a discuté Hegel, Schegel [hic], Kant &c. sous l'influence du whisky. »
“We had an extraordinary time & did not break up till after two in the morning. We talked metaphysics continually, & Hegel, Schegel [hic], Kant &c were discussed under the influence of the whiskey.”2
Kant définit la condition humaine comme le Royaume des fins ; Moby Dick (le livre) produit des significations sans fin et sans finalité.3 Moby Dick (le cétacé) n’est pas un symbole mais une une allégorie : comme le phallus il est poussé à remplir une fonction dont il ne connaît pas lui-même la raison. Comme dans les allégories médiévales, il n'a pas prise sur ce qu'il représente, sur ce qu'il fait, ni pourquoi. Il est dans la lignée du vieillard dans le Conte du Pardonneur de Chaucer, ce personnage troublant qui incarne peut-être le Temps, mais qui n'est lui-même qu'un simple mandataire, victime de sa propre condition :
« Ainsi je m’en vais comme un pauvre miséreux Et contre le sol, l’enclot de ma mère Je tape avec mon bâton, jour et nuit Disant : mère chérie, laisse-moi entrer. Vois comme je dépéris, chair et sang et peau Hélas ! quand mes os veront-ils le repos ? »
"Thus walke I, lyk a restelees caityf And on the ground, which is my modres gate I knokke with my staf, bothe erly and late And seye, 'leve moder, leet me in!' Lo! how I vanish, flesh, and blood, and skin! Allas! whan shul my bones been at reste?"
Ce qu’auraient dit Freud ou Lacan au sujet des mères et des bâtons n’a pas besoin d’explication. Foucault, lui, aurait souligné l’absence de « techniques de soi »
« qui permettent aux individus d'effectuer, seuls ou avec l'aide d'autres, un certain nombre d'opérations sur leur corps et leur âme, leurs pensées, leurs conduites, leur mode d'être ; de se transformer afin d'atteindre un certain état de bonheur, de pureté, de sagesse, de perfection ou d'immortalité. »4
Le poète Charles Olson, l’auteur d’une critique exemplaire du roman de Melville, y voit le déroulement infini de la connerie américaine. En tant que livre et en tant que figure, Moby Dick est une sorte de point de fuite cognitif, une configuration hégémonique sans aucun sens en soi, mais qui fait que tout s’organise en relation avec elle. Ce n'est pas par hasard que les trois harponneurs, Daggoo, Tashtego et Queequeg, sont respectivement un Noir africain, un Polynésien et un Indigène ; ce sont les seuls à ne pas se faire d'illusions sur le genre de bête qu'ils affrontent au quotidien:
« Nous agissons en grand, nous abusons de la terre, de nous-mêmes.... [Melville] a vécu intensément les torts de son peuple, sa culpabilité. Mais il s'est toujours souvenu du rêve premier. Moby Dick est plus fidèle que Feuilles d'herbe de Whitman, car c'est l'Amérique toute entière: l'espace, la malice, les sources. »
“We act big, misuse our land, ourselves…. [Melville] lived intensely his people's wrong, their guilt. But he remembered the first dream. The White Whale is more accurate than Leaves of Grass. Because it is America, all of her space, the malice, the root.”5
Melville, le premier des Woke: par l'intermédiaire de Moby Dick il confronte et bouleverse deux concepts fondamentaux de la philosophie kantienne, les principes régulateurs et l'unité synthétique de l'aperception :6
Kant pour les Nuls (et Cousin, ce qui revient au même) : 1] On ne peut donner un sens aux phénomènes matériels qu'en recourant à la Raison, suprême et abstraite. 2] Les déductions tirées de l'observation des phénomènes matériels sont quasiment dénuées de valeur objective puisqu’elles sont basées sur des sensations et que les sensations sont à leur tour limitées par les fonctionnements de nos sens et les conflits entre eux. Melville, avec son humour acerbe, trolle Kant : Pour Kant, seule une synthèse abstraite permetrait de réconcilier les perceptions que nous dérivons des sens, tandis que Moby a les yeux de part et d'autre de la tête, si bien qu’
« il voit donc forcément une image distincte d’un côté et une autre de l’autre »,
mais cela ne semble pas altérer ses nobles facultés de raisonnement,
« comme s’il était capable de faire simultanément la démonstration de deux problèmes différents en géométrie. » [Chapitre 74]
“He must see one distinct picture on this side, and another distinct picture on that side […] as if a man were able simultaneously to go through the demonstration of two distinct problems in Euclid.”
Melville n'est qu'un des nombreux artistes à avoir réduit la logique de Kant à un tortillon ; un jour je dirai leur histoire :
Quant au concept premier : Il existerait des forces universelles, abstraites et éthiques (les « idées régulatrices ») auxquelles tous les bien-pensants désirent se soumettre, et c'est là pour Kant et Cousin le sens de l'éducation supérieure. Ni l’un ni l’autre ne semblent sûrs de ce qui caractérise ces facultés qui permettent à la pensée bien-pensante de s'épanouir, si ce n'est que l'imagination (Empfehlung) figure en bonne place, « l’intuition pure du moi, en dehors de toute expérience ».7 Au bon vieux temps où on criait « l’imagination au pouvoir ! », on ne se doutait pas que le pouvoir a la mainmise sur l'imagination depuis 150 ans.
En effet, si la capacité à accéder à une vérité universelle repose avec chaque individu, alors toutes les épistémologies sont des épistémologies du positionnement, indépendamment de leur proximité ou leur éloignement de cette vérité unique et inaccessible de l’idéalisme Kantien. Du moment qu’il n’existe aucun moyen perceptible d'identifier les détenteurs de la vérité, la recherche de la vérité se réduit à la soumission à quiconque peut prétendre de manière crédible à l'autorité. En conséquence, les agressions visant la « Cancel culture » ou le « Wokisme » se réduisent à un jeu de « C’ui qui dit il l’est ! » : les accusateurs imitent les répressions dont ils accusent les autres, tandis que le caractère véridique de l'une ou l'autre position est suspendu en permanence par le recours à la « Raison ultime et abstraite » :
« Prétendre […] que certains points de vue sont à prendre comme vérité […] c'est céder à l'illogisme de l'épistémologie du positionnement. »8
Et vice-versa…
Dans l’introduction de The Post-Revolutionary Self, Jan Goldstein nous invite à lire Foucault avec prudence lorsqu'il s'agit d'aborder les postures du moi bourgeois :
« Bien que ses généalogies du moi moderne portent sur des questions de pouvoir et qu'elles soient situées dans un contexte historique général, elles manquent pourtant d’agents délibérés. »9
Lorsqu' on commence, comme le fait peut-être Foucault, par aborder le pouvoir comme une abstraction à part entière, alors le pouvoir devient une forme subsidiaire de l'idée régulatrice kantienne, intrinsèque à l'abstraction elle-même. Aujourd'hui désormais, le cours universitaire type est un morne jeu de roi du château, une lutte de monades isolées qui se démènent pour occuper la place de l'autorité, incarnation de la raison abstraite. L’énergie motivante est fournie par des "agents délibérés" dont le champ d'action, déterminé par le social, est dérivée dans ce cas particulier des techniques de régulation imposées par le système éducatif lui-même : la hiérarchie de l'imagination correspond à une hierarchie de l'administration. Il suffit de se rendre à la Harvard Coop, la librairie attitrée de la plus prestigieuse université américaine, pour s'en convaincre. Là où on s’attendait trouver les ouvrages les plus rigoureux, rédigés par les plus illustres esprits de l’Amérique, on trouve une masse de récits complaisants, la technique du moi portée à un autre niveau.
La ligne de démarcation entre le libéralisme kantien et l’idéologie du surhomme fasciste s’amincit de jour en jour. Il est temps d'admettre que cette situation ne peut être corrigée que par un changement dans les relations concrètes du pouvoir qui déterminent l'éducation en tant que pratique. C'est une leçon que les fascistes, en privilégiant le pouvoir, ont compris depuis longtemps. Il est temps que nous aussi nous comprenions.
1er Mai, 2023
WOID XXIII-10b4 4/4
Jacques Lacan, « La Signification du phallus », Conférence de Jacques Lacan le 9 mai 1958, Les Écrits (Paris: Seuil, 1999), pp. 685-695.
Melville, Journal, cité dans A Companion to Melville Studies, ed. John Bryant (New York : Greenwood Press, 1986), p. 174; voir aussi Shirley M. Detlaff, “Melville’s Aesthetics” dans A Companion to Melville Studies pp. 634-5.
Immanuel Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (Riga: Johann Friedrich Hartknoch, 1785).
Michel Foucault, « Les techniques de soi », Université du Vermont, octobre 1982 ; trad. F. Durant-Bogaert, Dits et écrits, Tome 2 : 1976-1988 (Paris, Gallimard, 2001), p. 1604.
Charles Olson, Call Me Ishmael (New York: Reynal & Hitch, 1947), pp. 14, 15.
Immanuel Kant, Critik der reinen Vernunft (Riga: Johann Friedrich Hartknoch 1781), p. 644.
Wilhelm von Humboldt; voir « La Médisance à l’école », III, note 2. https://theorangepress.substack.com/p/la-medisance-a-lecole-iii
John McWhorter, “DeSantis May Have Been Right” ; voir « La Médisance à l’école », I, note 3. https://theorangepress.substack.com/p/la-medisance-a-lecole-i
Jan Ellen Goldstein, The Post-revolutionary Self. Politics and Psyche in France, 1750-1850 (Cambridge, MA. Harvard University Press, 2005), 15.